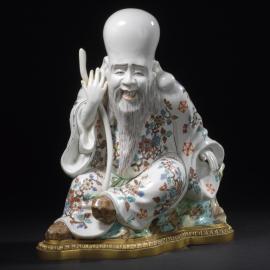Les courses de chevaux sont un thème à part entière dans la peinture européenne, mais jusqu’ici peu exploré. L’exposition est la première de chantilly à approfondir le sujet.
Q u’elle se déroule à Chantilly, haut lieu de l’hippisme en France, n’a rien d’étonnant. Encore fallait-il la volonté d’un homme, celle d’Henri Loyrette, bien connu pour avoir dirigé le musée d’Orsay puis le musée du Louvre, et actuellement membre du Comité d’administration du domaine de Chantilly. L’homme de l’art, étranger au monde des courses, s’est allié à un compère grand connaisseur de cet univers, l’écrivain Christophe Donner. Tous deux ont imaginé un parcours en trois temps, fondé sur l’œuvre de trois peintres majeurs, l’Anglais George Stubbs (1724-1806), et les Français Théodore Géricault (1791-1824) et Edgar Degas (1834-1917). Autour de ces protagonistes de la peinture de chevaux et de courses en son âge d’or, des dernières décennies du XVIII e siècle aux dernières du siècle suivant, sont aussi présentés quelques-uns de leurs contemporains.
Théodore Géricault , Course de chevaux , dit Le Derby de 1821 à Epsom , 1821, huile sur toile, 116 x 148 cm, Paris, musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Philippe Fuzeau
Le «sporting art» Cette histoire débute en Angleterre où, de longue date, l’on pratique les courses de chevaux, si prisées…
com.dsi.gazette.Article : 6422
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.