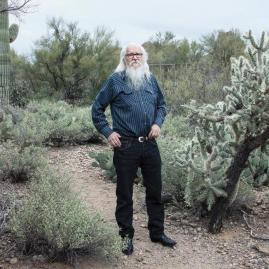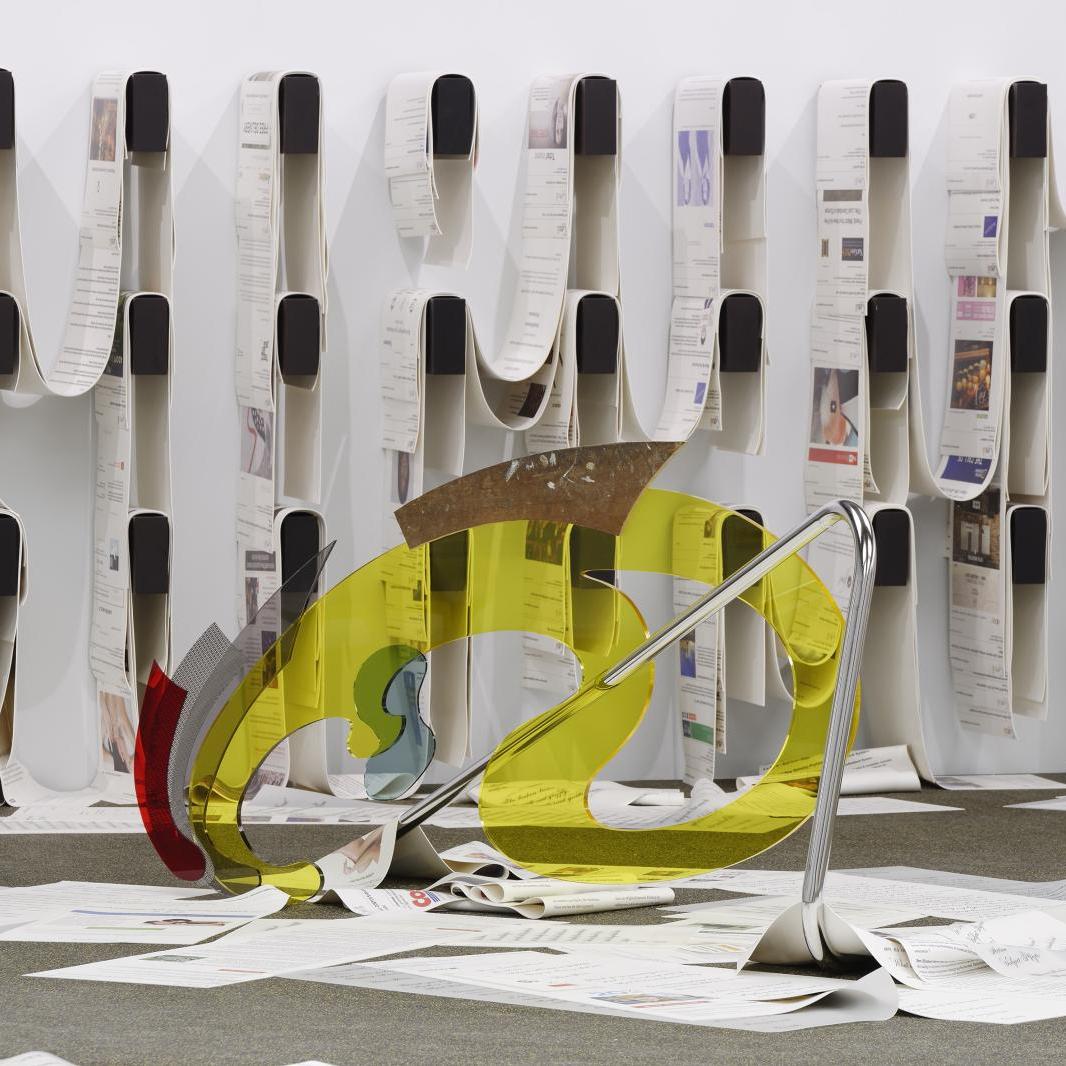Les fonds régionaux d’art contemporain échapperont-ils à la crise de la quarantaine ? Julie Binet, la secrétaire générale de Platform, association qui en coordonne le réseau, revient sur cette épopée culturelle unique afin d’en cerner les enjeux actuels.
En 1982, Jack Lang et Claude Mollard initient l’aventure des FRAC. À quoi ressemble alors le paysage institutionnel de l’art contemporain ? Les lieux dédiés à l’art contemporain étaient assez limités : le Musée de la Ville de Paris, le Centre Pompidou et, en province, les musées de Grenoble, Marseille, Toulon, Saint-Étienne et des Sables-d’Olonne. Les FRAC sont donc nés d’un souci volontariste de mettre à disposition de chaque collectivité territoriale un outil permettant d’entrer en contact avec l’art. Et ce, avec le moins d’intermédiaires possible. Claude Mollard était très attaché à cette idée de la rencontre directe avec l’œuvre. Jack Lang nous confiait, à l’occasion de la dernière assemblée générale de Platform, qu’il n’y croyait pas lui-même ! Or, quand Claude écrit à l’ensemble des conseils régionaux pour leur proposer de faire l’acquisition d’œuvres récentes et de les montrer au public, tous les élus, de gauche comme de droite, saisissent l’opportunité ! Les FRAC ont vite rencontré des résistances, Dominique Bozo essaie de les supprimer en 1987, quand il succède à Claude Mollard à la délégation aux arts plastiques. Que leur reproche-t-on alor ? Les critiques venaient en partie du corps très structuré des conservateurs du…
com.dsi.gazette.Article : 41790
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.