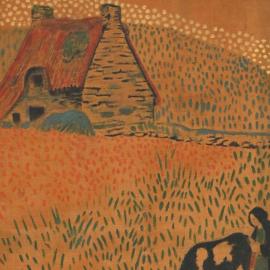Le XIXe siècle signa assurément la plus fameuse dichotomie dans le domaine de la tapisserie. Après une période sans génie, cantonnant la production tissée à des cartons académiques, la seconde moitié du siècle renouvelle la considération des artistes pour un art trop longtemps maltraité.
Alors que les réformes impériales bouleversent bien des domaines, les anciennes manufactures royales demeurent engluées dans un conservatisme certain. Depuis le Directoire, les arts décoratifs obéissent pourtant au caprice d’une fantaisie nouvelle ; mais jamais celle-ci ne juge nécessaire de considérer l’art tissé. Ce triste constat esquisse l’état de la tapisserie en ce jeune XIX e siècle, et tout semble indiquer que la situation n’est pas près de changer. En 1805, Napoléon I er passe commande aux Gobelins et à Beauvais de tapisseries et de portraits tissés sommés de copier fidèlement des tableaux de David, Gérard ou Gros. Les palais impériaux réclament des portières, garnitures de fauteuils, paravents, écrans ou tentures historiées mais rien qui ne considère les qualités intrinsèques des œuvres tissées sur métier. Pis, leur mécanisation dénigre encore davantage le savoir-faire des…
com.dsi.gazette.Article : 33610
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.