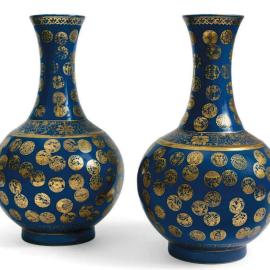Avant même l’ouverture du musée départemental de Flandre, le projet d’une exposition sur les fêtes et kermesses était dans ses cartons. Forte de la notoriété de ses dernières propositions et profitant de l’année Bruegel, largement célébrée en Europe, Sandrine Vézilier-Dussart s’attelle à ce nouvel opus avec une passion communicative, en parfaite symbiose avec ce thème entraînant.
Jan I Bruegel (1568-1625), Une fête villageoise , 1600, huile sur cuivre, 47,6 x 68,6 cm, Londres, The Royal Collection. © Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2019
D’où vous est venue l’idée de cette exposition ? Depuis l’ouverture du musée de Flandre, en 2010, je travaille dans le même sens : monter des expositions sortant des sentiers classiques, que ce soit par le choix des sujets explorés ou par la mise en lumière d’artistes moins connus. Et ce dans un seul but, celui de remettre la perception de la peinture flamande au cœur du processus créatif des XVI e et XVII e siècles. C’est le créneau que j’ai emprunté pour nous différencier et nous permettre d’exister. Le maniérisme est né en Flandre avant de s’épanouir en Italie, de même que l’art animalier. Et que dire de Bruegel l’Ancien justement, un artiste universel, fondateur d’une dynastie de…
com.dsi.gazette.Article : 6625
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.