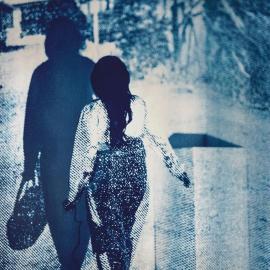Souvent confondu avec l’ambrotype, le procédé au collodion sur tissu ou cuir a émergé au milieu du XIXe siècle. Il n’est cependant pas encore bien identifié et reste considéré, à tort, comme une technique rare.
Comme dans un trou noir, des masses d’énergie considérables ont convergé vers la photographie au XIX e siècle pour s’annihiler sur tous les continents : ingénieurs, chimistes et inventeurs ont expérimenté, produit des traités ou déposé des brevets qui ont connu une vie éphémère et se sont déchargés. Ces expériences n’ont laissé la plupart du temps que des amas plus ou moins inertes, mais ont été consignées dans des manuels savants de l’époque. Qui connaît la wothlytypie, brevetée par le Suisse Jacob Wothly, ou la photoglyptie, inventée par le Britannique Walter Bentley Woodbury ? Elles ont pourtant bénéficié d’une diffusion internationale. Outre le daguerréotype, quelques procédés photographiques primitifs ont toutefois résisté, comme le ferrotype ou l’ambrotype. Peu connu, le panotype a alors émergé. Ce dernier se distingue assez facilement par son support textile ou en cuir et par des applications classiques : cartes de visite, imitations de peintures, ornementation de médaillons, tabatières ou autres boîtes. Son nom est simple et peut prêter à confusion, mais se mémorise facilement. Sur…
com.dsi.gazette.Article : 14483
Ce contenu est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.