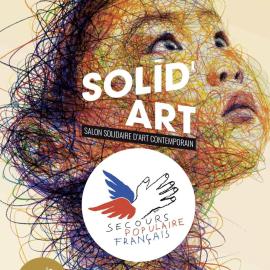À Sète, l’ex-directrice du centre régional d’art contemporain revient sur son parcours, les centres d’art, la scène actuelle française et ses projets.
Entre elle et les artistes, c’est une longue histoire qui s’écrit à travers la création d’écoles, de résidences, d’éditions et d’expositions. Intarissable, passionnée et passionnante, cette «fausse directrice de centre d’art» et «fausse commissaire d’exposition», selon ses propres termes, fut plasticienne avant de devenir l’instigatrice de la villa Saint Clair, puis du centre régional d’art contemporain (CRAC) à Sète. Délaissant sa pratique pour mettre en lumière celle des autres, elle révéla de multiples talents, désormais internationalement reconnus, et assure aujourd’hui la transition jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. Tout en songeant, pourquoi pas, à de nouvelles aventures artistiques, dont l’écriture. Retour sur sa carrière et sa vision engagée du métier, voué à la cause des artistes et du public. À quand remonte votre amour pour l’art ? Très tôt, j’ai su que mon destin était lié à ce monde. Chez le médecin de mon village, Culan, dans le Cher, il y avait des peintures dont l’une, intrigante et colorée, signée Maurice Estève, me fascinait. À la fin des années 1950, j’avais 10 ans et, malgré ma timidité, j’ai décidé de le rencontrer, puisqu’il habitait la commune, pour savoir comment faire pour «devenir artiste». À cette…
com.dsi.gazette.Article : 7331
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.