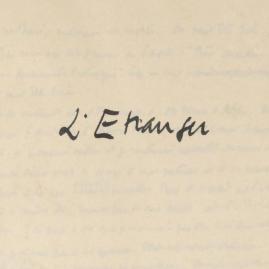Professeur au Collège de France, historien de la littérature française, Antoine Compagnon a récemment consacré un bel ouvrage à ce «philosophe du ruisseau», à l’origine du marché aux Puces. Récit.
Il fait partie des «cris de Paris», et pourtant il n’en a pas ! Au nombre d’une cinquantaine, les petits métiers ambulants sont reconnaissables aux appels que poussent le vendeur de confettis, le rémouleur, le marchand de peaux de lapin ou celle d’oublies… Silencieux, sauf quand il est ivre comme le veut la tradition, le chiffonnier, lui, fouille les tas d’ordures déposées au pied des bornes le long des rues, qui disparaîtront avec l’arrivée des trottoirs, à la recherche des vieux chiffons, alors indispensables à la fabrication du papier. Reconnaissable dès le Moyen Âge à sa hotte, sa lanterne et son chien, la police tentera de lui interdire ce compagnon et de travailler entre minuit et le lever du soleil , il ne se déplace pas non plus sans son crochet ; du bout de celui-ci, il attrape chiffons, papiers sales, cotonnades, toiles, restes de sacs et d’emballages, qu’il apporte et vend selon la qualité rue Mouffetard, haut lieu du quartier…
com.dsi.gazette.Article : 5085
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.