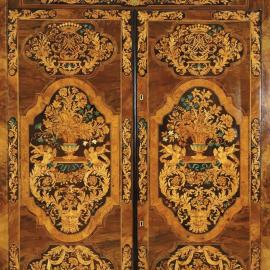Conçus à l’origine comme de simples documents mis à la disposition des designers, décorateurs et architectes, les fonds photographiques du musée des Arts décoratifs révèlent aujourd’hui leurs chefs-d’œuvre.
L’intérêt de l’«Union centrale des arts décoratifs» (UCAD) pour la photographie remonte à ses balbutiements, lorsque les industriels français, sonnés par l’hégémonie britannique à l’Exposition universelle de Londres en 1851, décident de tout mettre en œuvre pour relever le défi. Dès ses premières expositions au palais de l’Industrie, dans les années 1860, celle qui s’appelle encore l’«Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie» – et qui deviendra en 2004 Les Arts Décoratifs – met en avant ce nouveau support, considéré comme le fer de lance d’une documentation moderne, indispensable aux artisans, architectes et professionnels pour renouveler leur répertoire. Nombreux sont alors ses membres, industriels, artistes ou simples amateurs, qui vont fournir grâce à leurs dons ou legs l’institution en la matière. «À Constantinople, j’ai acheté chez un photographe 294 photographies […] des vues d’architecture d’ensemble, et puis tous les détails que j’ai pu trouver, arabesques, armes, faïences, boiseries. J’y ai ajouté quelques costumes», écrit Jules Maciet en 1891 au président de l’UCAD. Ces images prendront place, en compagnie de dessins, gravures ou publications soigneusement découpés par lui-même dans les cinq mille «albums Maciet»,…
com.dsi.gazette.Article : 25595
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.