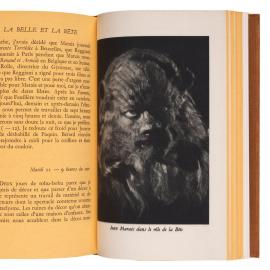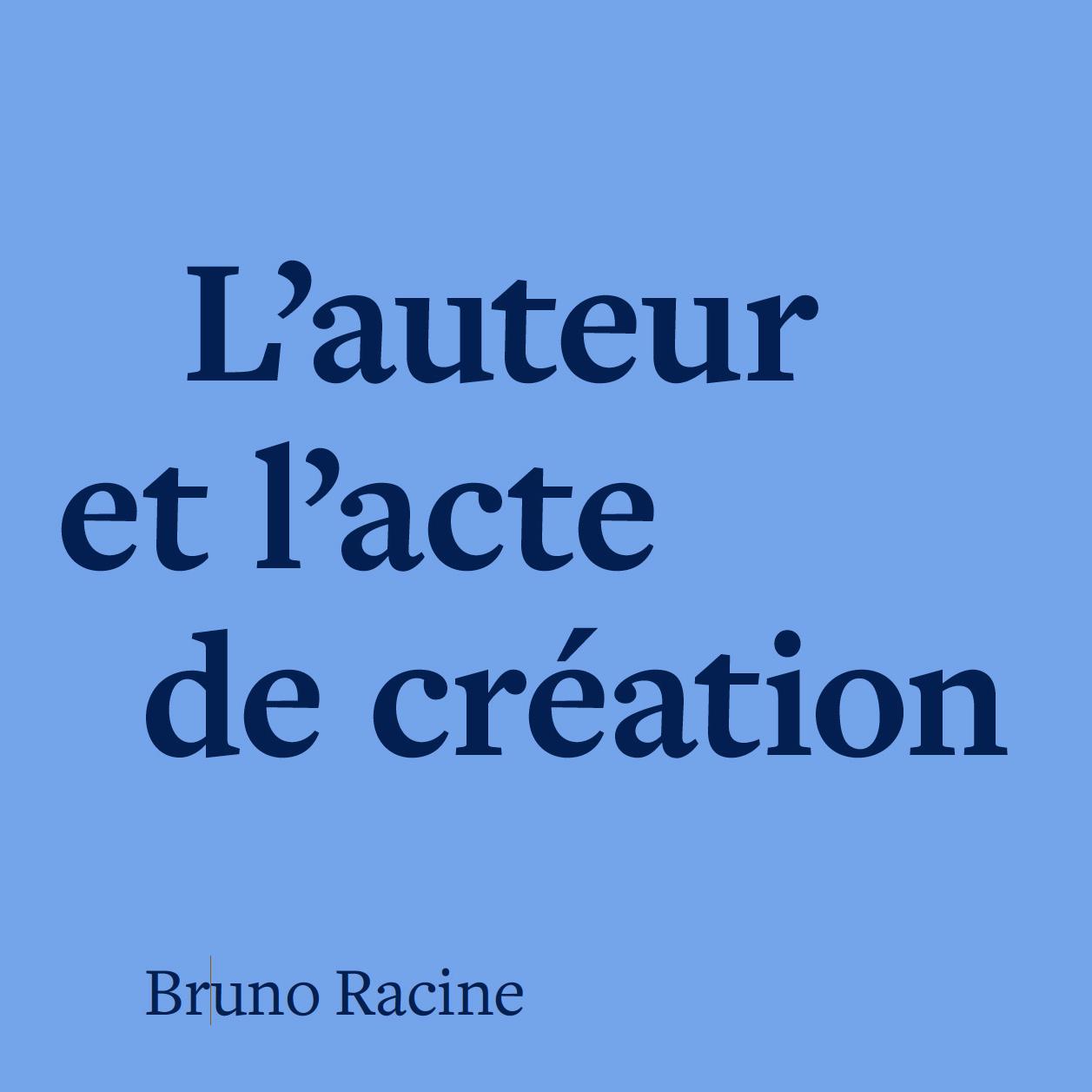Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme explore la fécondité de cette légende juive d’Europe centrale et s’interroge sur ses variations littéraires, plastiques et cinématographiques, sans oublier sa féconde descendance dans le domaine de la robotique et de l’informatique.
Il était une fois un être pétri du limon de la rivière Vltava à Prague. Un géant aux pouvoirs surhumains fabriqué par le rabbin Yéhoudah Loew, dit le Maharal de Prague (vers 1525-1609), pour protéger des persécutions la communauté juive de la ville, accusée de meurtres rituels. Selon une légende pragoise, ce colosse aux pieds d’argile prendrait vie en traçant sur son front le mot « emet » («vérité» en hébreu), et il suffirait d’effacer la lettre hébraïque alef afin de faire apparaître le mot met («mort») pour la lui ôter. La créature reposerait aujourd’hui dans le grenier de la synagogue Vieille-Nouvelle de Josefov, l’ancien quartier juif de Prague, où l’on peut encore voir le fauteuil du célèbre rabbin, dans lequel personne ne se serait assis depuis sa disparition. Une exposition intitulée «Golem ! Avatars d’une légende d’argile» explore la postérité dans les arts visuels de cette figure popularisée par le roman fantastique de l’écrivain autrichien Gustav Meyrink en 1915, et le film expressionniste du réalisateur allemand Paul Wegener, Der Golem, wie er in die Welt kam ( Le Golem, comment il vint au monde , 1920) dans un parcours mêlant peinture, dessin, photographie, théâtre, cinéma, littérature, bande dessinée…
com.dsi.gazette.Article : 8245
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.