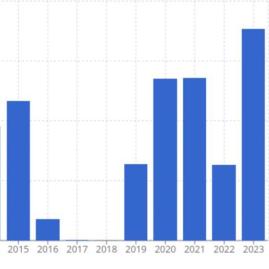À l’occasion de sa première rétrospective, organisée par le Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau, l’artiste nous ouvre les portes de son atelier, installé en banlieue parisienne. Un univers enchanté.
Sa journée de travail commence tôt, vers sept ou huit heures, moment le plus propice à la clarté de la pensée. Par chance, elle n’a que quelques mètres à parcourir depuis sa maison pour retrouver ses pinceaux. Lorsqu’en 2009 elle a emménagé à Cachan, avec son mari le photographe Hervé Plumet et leurs deux enfants, elle avait réuni deux chambres pour constituer son atelier. S’y est substitué celui qu’elle a fait construire en 2011 dans le jardin : un cube moderniste aux murs blancs percés de baies vitrées, donnant sur un environnement végétal – inattendu dans cette banlieue parisienne – avec palmier, sapin et magnolia. C’est dans ce havre verdoyant que Françoise Pétrovitch (née en 1964) manipule huile et encres, à moins qu’elle ne modèle la terre. Un atelier de plus dans sa liste car, depuis ses débuts dans les années 1990, l’artiste en a expérimenté plusieurs, collectifs ou aménagés dans une pièce de son domicile. «Même dans les lieux les plus petits, je me suis toujours débrouillée», assure-t-elle. Cela probablement parce que dès sa plus tendre enfance, bien que vivant à la campagne, éloignée du monde des musées, elle était animée par la fibre créatrice… À 6 ans, elle avait déjà décrété qu’elle ferait…
com.dsi.gazette.Article : 31807
Ce contenu est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.