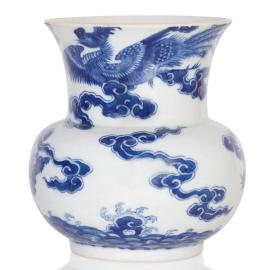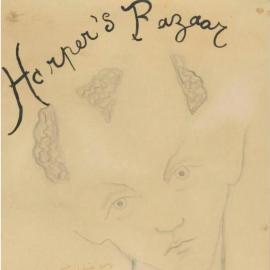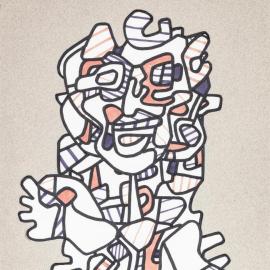La collection Hugo von Ziegler-Schindler revient sur le devant de la scène des enchères, avec un ensemble de dessins anciens. Une place toute particulière y est réservée aux œuvres suisses.
Hugo von Ziegler (1890-1966) a passé toute sa vie à Schaffhausen. L’information n’est pas anodine, elle est même au fondement de la carrière et des passions de l’homme. Cette ville, chef-lieu du canton du même nom, est située au nord de la Suisse, dans la partie alémanique du pays. Riche famille de banquiers, les von Ziegler y sont installés depuis plusieurs générations. Si Hugo adopte la profession familiale, il se distingue en se consacrant largement à sa passion : l’histoire de l’art. Naturellement épris de ses racines, il porte son attention sur les arts de son pays et de sa ville d’origine, en étroite liaison avec le musée de sa ville, qu’il aide aussi financièrement. Tout comme sa collection numismatique, dispersée en 2014 également à Drouot par l’étude Joron-Derem, ses pièces d’argenterie et, surtout, ses dessins anciens sont de véritables hymnes patriotiques. Cette passion, il l’a partagée à partir de 1921 avec son épouse, Edith Schindler, issue d’une famille très aisée et déjà collectionneuse.
Une collection historique Le couple fit ses plus belles acquisitions dans les années suivant le mariage. Totalement attachée à ces œuvres, Edith prenait un grand plaisir à réaliser de ses propres mains les montages et les chemises pour chaque feuille, écrivant fort élégamment le nom de l’artiste. Durant quarante années, ils consacrèrent leur temps libre et leur argent à la réunion de cette importante collection de dessins du XVI e au XIX e siècle. Léguée à leurs trois enfants à leur mort, elle a déjà connu une première dispersion en 2009 chez Sotheby’s…
com.dsi.gazette.Article : 7592
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.