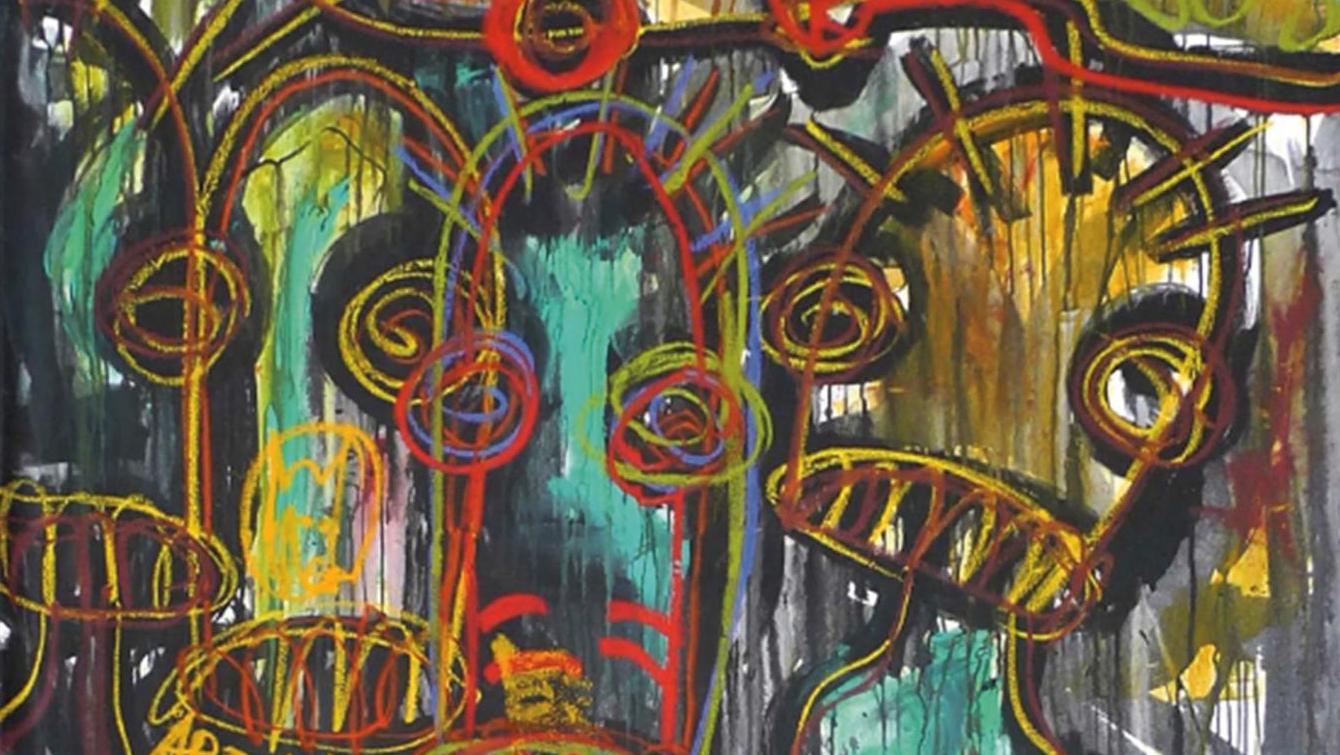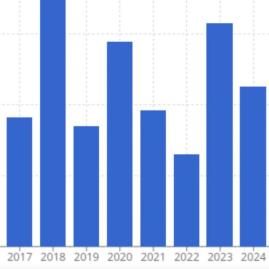L’Hôtel des ventes offre durant une semaine ses cimaises à huit artistes contemporains africains, engagés pour la cause des enfants soldats. Une double reconnaissance.
Changement complet de ton pour s’inscrire dans la continuité. Alors que l’univers onirique du peintre Ferdinand Desnos vous y étonne encore, Drouot invite l’art contemporain africain à occuper ses murs, et pour cela a fait appel à une toute jeune fondation. Une belle et double occasion : celle de s’associer à et ainsi de rappeler la Journée mondiale des enfants soldats, initiée par l’Unicef le 12 février ; celle ensuite de surfer sur la vague ascendante de cette spécialité, de plus en plus présente sur la scène internationale et sur le marché de l’art. À l’heure de la question brûlante des restitutions, cette thématique permet également de faire état d’une vision dynamique de l’Afrique et de sa vitalité créatrice. En novembre 2018, la troisième édition d’AKAA (Also Known as Africa) se tenait au Carreau du Temple, sous la direction de la pétillante Victoria Mann. Les 23 et 24 février prochain, la foire 1-54 présente à Londres depuis six ans et à New York depuis cinq investit de nouveau les salons de La Mamounia, annonçant dix-huit galeries internationales et soixante-cinq artistes émergents ou déjà installés. Plusieurs noms sont éminemment associés au paysage international et figurent dans les grandes collections. On ne présente plus Ousmane Sow, le Ghanéen El Anatsui, ni encore…
com.dsi.gazette.Article : 5242
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.