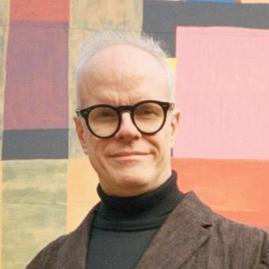L’INHA s’est livré à un jeu de pistes et à un travail de fourmi : recenser les œuvres du musée d’Alexandre Lenoir dans sa base Agorha. Béatrice de Chancel-Bardelot nous en dit plus.
L’exposition «Un musée révolutionnaire, le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir», à voir au Louvre jusqu’au 4 juillet, est l’occasion de se pencher sur le travail d’un organisme peu connu du grand public, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Créé en 2001, il a permis à la France de se doter d’une structure, comparable à celles existant déjà dans nombre de grands pays occidentaux, s’appuyant sur une bibliothèque étoffée à partir du socle documentaire légué à l’Université de Paris, en 1918, par le couturier et collectionneur Jacques Doucet. Avec plus de 1,5 million de documents, faisant le bonheur des historiens de l’art, des étudiants et des professionnels, elle représente le plus grand fonds d’histoire de l’art en Europe.
Germain Pilon (vers 1525/1535-1590), Tombeau de Valentine Balbiani, département des sculptures, musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Thierry Ollivier
La base agorha Ce fonds devrait prendre place dans la salle Labrouste de la Bibliothèque nationale (site Richelieu) mi-décembre 2016, une fois les travaux de rénovation achevés. L’INHA a en outre constitué une trentaine de bases de données, en partie mutualisées et regroupées sur sa plate-forme Agorha (Accès global et organisé aux ressources en histoire de l’art). La plus connue est…
com.dsi.gazette.Article : 9028
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.