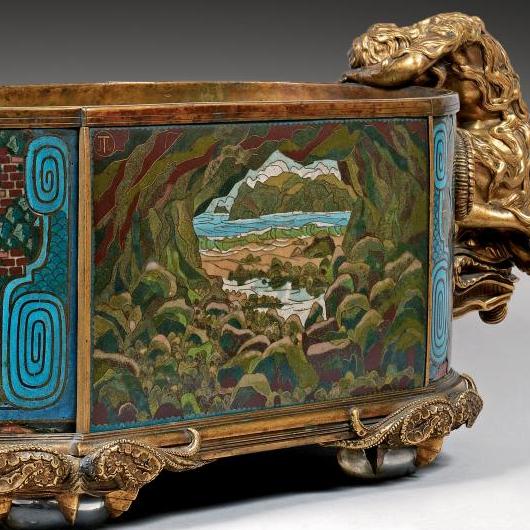160 000 € récoltés, 300 adhésions, sept réseaux d’entreprises partenaires… En cinq ans, le Cercle des femmes mécènes du musée d’Orsay a doucement pris forme, au rythme de l’évolution des mentalités.
À l’automne 2013, en l’espace de quinze jours, le musée d’Orsay inaugurait une exposition «Masculin/Masculin» et le premier cercle de femmes mécènes d’un musée. Un grand écart ? Rien n’est moins sûr. Hors des sentiers battus, les deux initiatives positionnent l’établissement en faveur de la diversité, par le truchement d’un discours entre art et égalité. Présidente et cofondatrice du Cercle InterElles, qui regroupe des entreprises comme Engie, Dassault Systèmes ou Orange et œuvre en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle dans les secteurs scientifiques et technologiques , l’un des trois premiers réseaux fondateurs du Cercle des femmes mécènes (CFM), Catherine Ladousse estime que «le CFM est arrivé à monter en puissance sans dénaturer ses objectifs de départ, à savoir réunir des personnes intéressées par les arts. Après l’exposition sur les femmes photographes en 2015, le Cercle a été moins sollicité. L’arrivée de Laurence des Cars (présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie depuis 2017, ndlr), qui a l’air très engagée, devrait nous emmener vers une nouvelle étape grâce à une programmation qui apporte du contenu sur la question féminine». Outre une année inaugurale…
com.dsi.gazette.Article : 5102
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.