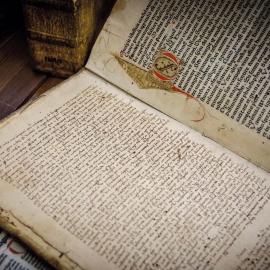Heureux hasard de l’édition, alors que paraît le troisième recueil dédié à l’œuvre de Charles de Beistegui, « Le Parc de Groussay », une biographie sort sur ce milliardaire féru de décoration. Bienvenue dans un monde délicieux de légèreté…
Passer à la postérité pour avoir donné un bal, c’est l’exploit qu’accomplit Charles de Beistegui. Nous en reparlerons. Le personnage, d’après la biographie qui paraît sur lui, n’est pas follement sympathique : «égocentrique», «tyrannique», «d’un snobisme maladif»… En revanche, il est beau, spirituel, et doté d’un goût exquis pour la décoration. Qu’on se rassure, il n’en fera pas profession. Travailler ? Une idée aussi saugrenue ne lui est jamais venue. Charles de Beistegui est très occupé à dépenser la fortune acquise par sa famille dans l’extraction minière au Mexique. Né à Paris, en 1895, élevé dans le très chic collège anglais d’Eton, armé d’un passeport espagnol, Charlie – comme l’appellent ses proches – se partage entre mondanités, voyages et l’aménagement de ses demeures. Il a, d’abord, l’envie d’un penthouse sur le toit d’un immeuble des Champs-Élysées appartenant à son grand-père. Il sollicite Le Corbusier, star de l’avant-garde. Sans doute le commanditaire veut-il surpasser ses amis les Noailles, qui ont fait construire une mai- son cubiste à Hyères par Mallet-Stevens. Lorsqu’en 1931, après des échanges épistolaires tendus, l’architecte livre enfin l’appartement, Beistegui le trouve austère, trop pur, trop blanc. Finalement, il déteste la modernité. Il s’empresse d’y apporter sa touche : des candélabres à volonté, des meubles rocaille, des draperies, des…
com.dsi.gazette.Article : 42293
Ce contenu est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.