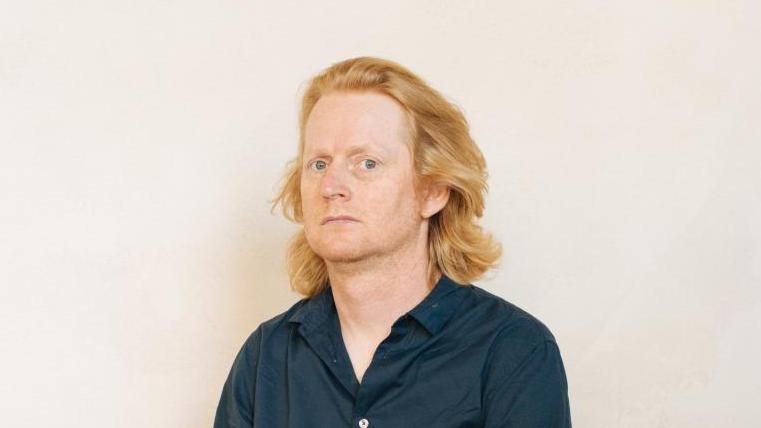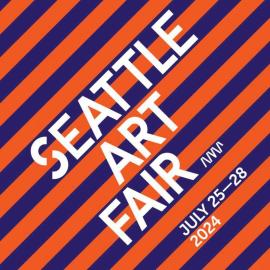À l’occasion d’une exposition dédiée à Donald Judd, qu’il organise à la galerie Thaddaeus Ropac, son fils livre une vision sans filtre de l’artiste et de l’homme, tout en évoquant la Judd Foundation.
Flavin Judd.
photo charlie rubin © judd foundation
Le microcosme de l’art contemporain semble tout savoir de Donald Clarence Judd, né en 1928 dans le Missouri. Est-ce vraiment le cas ? Emblématique du courant minimaliste américain aux formes élémentaires, fabriquées industriellement et dénuées de récit, l’artiste, mort à Manhattan en 1994, laisse un lourd héritage à ses deux enfants, Rainer et Flavin Judd. Outre une dette conséquente à éponger, les deux héritiers ont eu pour obligation, selon le testament paternel, de conserver des bâtiments vieillissants l’immeuble du 101, Spring Street, à New York, et vingt bâtisses à Marfa, au Texas, avec leurs œuvres d’art et le mobilier. Ils ont créé la Judd Foundation – Rainer en est la présidente et Flavin le directeur artistique – qui se porte bien aujourd’hui, malgré les difficultés des débuts. Une œuvre mémoire d’un artiste historique, que Flavin Judd entretient depuis vingt-cinq ans.
Bar (1981) de Carl Andre , Wall Drawing # 1176 , Seven b asic c olors and a ll t heir c ombinations in a s quare w ithin a s quare (2005) de Sol LeWitt , et Untitled , 1986-87, de Donald Judd . © Carl Andre / Adagp, Paris, 2019 © 2019 Estate f Sol LeWitt / Adagp, Paris, 2019 Donald Judd Art © Judd Foundation / Adagp, Paris, 2019
Comment avez-vous conçu cette exposition, une première en…
com.dsi.gazette.Article : 6086
Ce contenu est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.