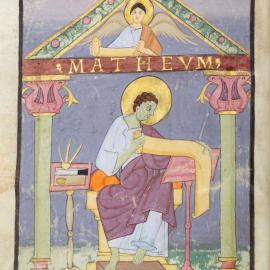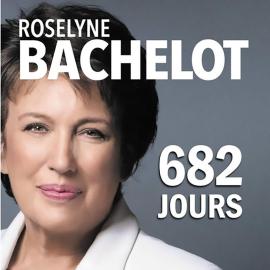Le destin du très controversé Bouquet of Tulips, offert par Jeff Koons à la Ville de Paris en hommage aux victimes du terrorisme, se trouve aujourd’hui entre les mains du ministère de la Culture. Quel est son avenir ? Éléments de réponse.
On se souvient de la polémique déclenchée par l’installation des colonnes de Buren au Palais-Royal, de même que de celle provoquée par la construction de la pyramide de Pei. Dans les deux cas, il s’agissait de commandes de l’État. Plus récemment, Dirty Corner , signé Anish Kapoor et surnommé le «vagin de la Reine», a suscité une levée de boucliers lors de son implantation dans le parc du château de Versailles, tout comme Tree de Paul McCarthy, mi-sapin de Noël mi-plug anal, lové place Vendôme à Paris. Un moindre mal : leur présence était temporaire. L’affaire du Bouquet of Tulips de Jeff Koons relève d’un autre genre : il s’agit d’un don. C’est Jane D. Hartley, alors ambassadrice des États-Unis, qui, après la tuerie du Bataclan en novembre 2015, avait suggéré à l’artiste d’offrir une œuvre à la Ville de Paris, en hommage aux victimes. Proposition qu’Anne Hidalgo s’était empressée d’accepter en sa qualité de maire, la sculpture étant présentée comme un geste de solidarité avec le peuple français. Dans la foulée était déterminée sa localisation, non pas imposée comme on a pu le lire, mais choisie par…
com.dsi.gazette.Article : 4550
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.