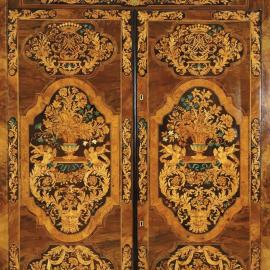Parmi les plus récentes découvertes faites au château de By, dernière demeure de la grande peintre animalière, la photographie est omniprésente. Quelle place a-t-elle tenue dans sa vie et son œuvre ? Un vaste sujet s’ouvre à la recherche.
Le jour du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, le 16 mars 2022, a donné le coup d’envoi d’une année de publications et de manifestations culturelles. L’occasion de redécouvrir l’œuvre d’une forte personnalité, star de son vivant mais vite oubliée après sa mort à 77 ans, le 25 mai 1899. L’exposition «Le musée des œuvres disparues», actuellement au château de By à Thomery (Seine-et-Marne), présente certaines des trouvailles faites par Katherine Brault et ses filles, propriétaires du lieu depuis 2017. Avec l’aide de l’archiviste Michel Pons, elles ont entrepris de répertorier et de classer les milliers d’objets et documents retrouvés dans cette vaste demeure, occupée par Rosa Bonheur les quarante dernières années de sa vie, parmi lesquels des plaques de verre, des clichés sur papier et du matériel photographique. Le style léché de la peintre animalière la plus célèbre du second Empire, son souci des détails et des textures, sa technique à l’ancienne, ses sujets, pourraient laisser croire à une volonté de rester en dehors de son temps. Mais ce serait faire fi de son tempérament aventurier et n’avoir pas bien regardé son œuvre. N’est-il pas d’un réalisme «photographique», comme l’ont qualifié certains de ses critiques contemporains ? Enthousiaste et curieuse de tout, Rosa Bonheur s’intéresse de près aux sciences, naturelles et vétérinaires en particulier. Habituée du Jardin des Plantes, elle constitue une belle bibliothèque scientifique dans son château de By, acquis en 1859 et qu’elle fera électrifier en 1898. Et la photographie y est partout présente.
Rosa Bonheur (1822-1899), Cheval de profil droit , cyanotype rehaussé de graphite et gouache blanche sur papier vélin, 1892, 17,6 x 23,8 cm. © Archives…
com.dsi.gazette.Article : 34566
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.