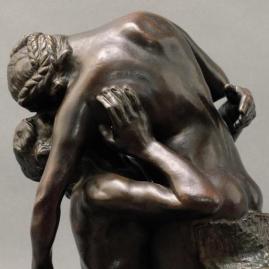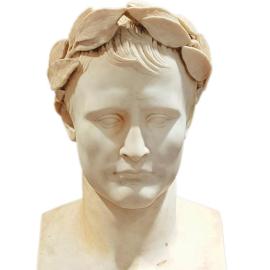Près de trois cents ans après sa mort, 60 dessins de Massimiliano Soldani réapparaissent à Paris. Une «découverte miraculeuse», selon l’historien d’art Charles Avery, qui permet d’ajouter le substantif de dessinateur à celui de sculpteur.
Dans l’inventaire après décès de Massimiliano Soldani (1656-1740), dressé le 23 mars 1740, 610 dessins du sculpteur et médailleur, rangés dans huit classeurs, sont bien recensés dans son atelier florentin. Mais, malgré certaines tentatives timides et erronées, notamment en 1962 et 1976, aucun historien de l’art n’était jusqu’alors parvenu à identifier la main de Soldani. Les sources étaient relativement limitées, puisque la seule mention par l’artiste d’une feuille autographe apparaît dans une longue lettre, adressée en mai 1695 au prince de Liechtenstein, à laquelle il joignit deux dessins d’urnes réalisés par l’un de ses assistants, «n’ayant pas le temps de faire ce genre de choses moi-même». Le présent portefeuille a longtemps été conservé par les descendants des Siries, une famille française de médailleurs, directeurs de l’Opificio delle pietre dure (manufacture de mosaïques de pierres dures) à Florence de père en fils entre le milieu du XVIII e et le milieu du XIX e siècle, expliquant ainsi l’état exceptionnel des dessins. Les feuilles ne portaient aucune inscription, mais cinq compositions sont clairement…
com.dsi.gazette.Article : 7106
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.