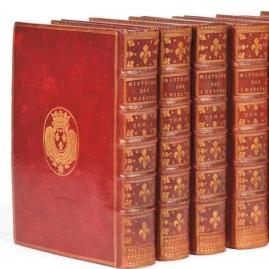Un buste du philosophe des Lumières, signé par Houdon en 1778, sera proposé aux enchères le 31 janvier à Drouot. À Oxford, une fondation travaille depuis cinquante ans à la publication de ses œuvres complètes.
Dans une maison victorienne d’Oxford, une réplique de ce buste de Voltaire, sculpté l’année de sa mort, surveille d’un regard légèrement ironique une poignée de chercheurs auxquels l’auteur des «lettres anglaises» a légué une mission qui paraît relever de l’impossible : étudier et publier l’intégralité de ses écrits. Il faudra compter plus de deux cents volumes pour contenir la production du plus insatiable graphomane de tous les temps. Après cinquante années de travail, il en reste une vingtaine à publier d’ici 2020 si la fondation Voltaire parvient à trouver les fonds nécessaires. Par la suite, elle compte aborder la numérisation de cet ensemble, qui lui permettrait d’intégrer plus facilement les enrichissements et de partager les fruits de cette recherche avec un public bien plus large. L’entreprise est digne de l’héritage d’un des premiers penseurs de l’idée européenne : l’ironie de l’histoire a voulu que cette publication, en français, soit conduite au cœur de cette Angleterre dont il admirait par contrepoint le libéralisme. Elle est due à la vie agitée d’un lettré excentrique, Theodore Besterman (voir p. 161), qui a légué ses archives à l’université d’Oxford ; à charge pour elle d’édifier ce temple littéraire. Chaleureux, doté d’une finesse d’esprit et d’un humour très voltairiens, le professeur Nicholas Cronk, qui dirige la fondation depuis 1998, nous a reçu dans cette résidence sise au 99 Banbury Road. L’idée de publier la première édition fiable de cette immense production a été proposée à Besterman en 1967, par William Barber et Owen Taylor, lors du deuxième Congrès international sur les Lumières, à l’université de St Andrews, en Écosse. Jeroom Vercruysse, de l’université libre de Bruxelles, a raconté comment, un peu plus tard, René Pomeau l’avait invité, avec d’autres éminents voltairiens, au Reform Club de Londres, où Besterman leur proposa de remplacer «l’édition Moland» du XIX e siècle (la 37 e depuis la mort de Voltaire, lui-même ayant alimenté…
com.dsi.gazette.Article : 8780
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.