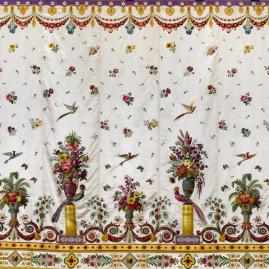À Rouen, le maire socialiste a ranimé la flamme de sa campagne pour déplacer la statue équestre de Napoléon qui trône depuis un siècle et demi devant l’hôtel de ville et l’abbatiale Saint-Ouen. Tout un symbole : c’est une rupture du consensus qui se manifeste dans cette velléité de nier l’Histoire. Les habitants ont été...
À Rouen, le maire socialiste a ranimé la flamme de sa campagne pour déplacer la statue équestre de Napoléon qui trône depuis un siècle et demi devant l’hôtel de ville et l’abbatiale Saint-Ouen. Tout un symbole : c’est une rupture du consensus qui se manifeste dans cette velléité de nier l’Histoire. Les habitants ont été invités à « statuer » par un vote, dont le résultat était attendu alors que ce numéro était sous presse. Quel qu’il soit, il ne peut qu’entériner la division des esprits. Le maire a suggéré un départ de l’Empereur dans une île, sans une once d’ironie. Il souhaiterait remplacer son…
com.dsi.gazette.Article : 30562
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.