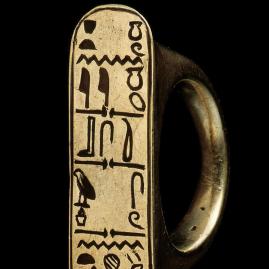Alors que le phénomène est réputé concerner les grands sites archéologiques des pays en guerre, la France souffre d’une recrudescence de pillages sauvages. La riposte des archéologues et du ministère s’organise.
Attachants », « bienveillants », « drolatiques » … La critique française ne tarit pas d’éloges sur Andy et Lance, deux bons à rien détectoristes. Série britannique, Detectorists serait même une « ode aux plaisirs simples »… et au loisir illégal ! Car si la législation anglaise autorise le ratissage des sols, en France, l’activité pourtant strictement encadrée continue de faire des ravages. « Lara Croft, Indiana Jones… Les figures d’archéologues aventuriers peuplent notre imaginaire et nourrissent une vision fantasmée de la découverte archéologique », regrette Dominique Garcia, président de l’Inrap, Institut national de recherches archéologiques préventives. « Le vestige archéologique intéresse moins l’archéologue que son contexte. La démarche archéologique de laquelle découle un savoir répond à une problématique précise qui nécessite une méthode de fouille rigoureuse, enregistrant l’ensemble des informations d’un terrain. Sortir un objet aussi beau soit-il du sol sans informations sur son environnement, sans étude des strates, revient à arracher la dernière page d’un roman policier. Vous aurez le nom du coupable mais sans connaître l’histoire. Donc vous ne comprendrez rien », explique Xavier Delestre, conservateur-archéologue à la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pourtant en…
com.dsi.gazette.Article : 42556
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.