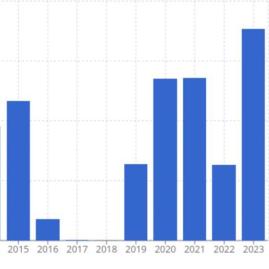Quand l’expérience physique et esthétique des ondes lumineuses passe par les faisceaux de cette artiste, le visiteur perd certains repères. Ses immersions auraient même des effets sur notre psychisme. Explications.
La matière travaillée par Nathalie Junod Ponsard (née en 1961) nous propose divers voyages. «La lumière est un flux. Elle glisse, est continue et transporte notre perception entre stabilité, instabilité et temporalité». Tantôt glissante, s’infiltrant en lignes serpentines des tubes leds très fins recouverts de filtres gélatine dans les cloisons du musée d’Art contemporain de Chengdu en Chine ; tantôt flottante, créant une ligne d’horizon en apesanteur sur les murs du MACRo à Rome ; tantôt dépliée, circulant sur les façades du nouveau bâtiment Austerlitz à Paris, conçu par l’architecte Jean Mas, «amenant le passant dans un jeu de regard au mouvement continu». Jouant avec l’élasticité des variations chromatiques, dédoublant les flux lumineux, créant des énergies spatiales, l’artiste nous pousse dans des paysages virtuels, géométriques, où l’horizon se dilue puis renaît selon les aléas de notre subconscient. Nathalie Junod Ponsard est formelle : «Certaines lumières peuvent avoir un effet psychotrope sur notre métabolisme. Il y a une douzaine d’années, j’ai effectué une série d’expériences sur quelques-unes d’entre elles dans diverses installations, comme à la Gaîté…
com.dsi.gazette.Article : 7610
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.