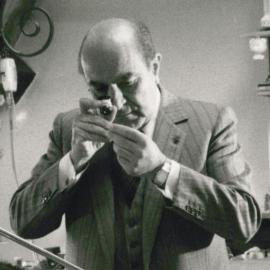Derrière ce mot énigmatique se dissimule un savoir-faire unique. Protégé depuis plus de deux siècles, il contribue à la réalisation du roi des parures de tête : le diadème.
À peine de retour d’une exposition à Tokyo, les maillechorts ont retrouvé les murs de l’hôtel Baudard de Saint-James, 12, place Vendôme à Paris, tant ils sont emblématiques du joaillier. Conçus pour leur valeur utilitaire, ils ont atteint un statut esthétique en devenant des objets d’art à part entière auxquels la maison, soucieuse de promouvoir son savoir-faire, recourt lors de ses présentations à travers le monde : au Japon cette année, pour célébrer à sa manière le 160 e anniversaire des relations avec la France, et en Chine en 2017. Bien sûr, le maillechort n’aura jamais l’éclat de l’argent, mais il dispose d’un charme et d’une valeur patrimoniale qui ne laissent pas indifférent. Signature originale de la maison fondée en 1780 par Marie-Étienne Nitot, il est attaché au diadème dont l’enseigne a fait son symbole depuis celui dessiné pour l’impératrice Marie-Louise en 1810. La réalisation d’un diadème requiert de nombreuses étapes et la participation de tous les corps de métier de la haute joaillerie, comme la fabrication du maillechort. Inventé en 1829 par les Lyonnais…
com.dsi.gazette.Article : 3223
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.