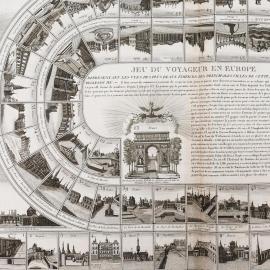Passe-temps guerrier dont l’objectif est la capture du roi adverse, cette distraction de haut vol a longtemps été l’apanage des grands de ce monde.
Les spécialistes s’accordent à penser que les échecs seraient nés en Inde au Ve siècle alors qu’un sage, chargé de l’éducation d’un jeune prince, aurait imaginé ce divertissement intelligent pour son élève. Version remise en cause au XVIIIe siècle après la découverte dans les cendres de Pompéi d’un authentique jeu d’échecs… Destins croisés Dans l’Europe du XIIe siècle, l’échiquier reste la chasse gardée des couches sociales élevées, et les parties livrées sont rapides et sans tactique, comme les corps à corps des guerres médiévales. C’est d’ailleurs à la faveur des croisades et des grands échanges culturels entre Orient et Occident que le jeu se généralise en Europe. Il faut néanmoins attendre la fin du Moyen Âge pour voir les règles évoluer. En effet, l’apparition des armes à feu sur les champs de bataille, perturbant les lois de la guerre, bouleverse les règles sur l’échiquier. Conséquence la plus directe, des pièces peuvent désormais se prendre de loin, ce qui permet à la partie de gagner en nervosité, et aux amateurs de la discipline d’étrenner de nouvelles stratégies plus sophistiquées. Rien…
com.dsi.gazette.Article : 6346
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.