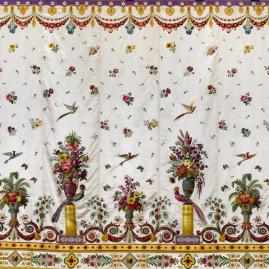Épargné par les flammes, cette création unique de La Savonnerie est en cours de restauration dans les ateliers du Mobilier national, entre des mains expertes.
Face à l’immense vitre d’une salle surnommée «l’aquarium», deux restauratrices sont penchées sur un large tapis, posé à cheval sur une table, à l’envers. D’un geste vif, l’une frotte son fil de lin sur un morceau de cire et enfonce une aiguille courbe dans l’épaisse armure, pour consolider la trame horizontale. L’autre s’applique à restituer une chaîne verticale en coton dans un fond couleur lilas. À leurs pieds, roulée, patiente la partie déjà soignée. Depuis juillet, les restauratrices du Mobilier national travaillent sur le tapis de chœur de Notre-Dame de Paris. Chef-d’œuvre du XIX e siècle méconnu du grand public, cette pièce est unique dans l’histoire de La Savonnerie par sa taille (23,8 x 7,38 mètres, soit 186 mètres carrés), sa destination, son décor néogothique, ses attributs liturgiques et ses stigmates historiques. «Nous sommes dans la partie haute», précise Julienne Tsang, responsable adjointe de l’atelier de restauration (le tapis avait été tissé en quatre morceaux, rentrayés deux à deux puis en seul, ndlr). Nous avons fait à peu près 4,60 mètres, en travaillant à deux ou trois selon les besoins, ajoute-t-elle. Hormis quelques dégâts de mites, ce tapis est peu usé. La plus grande difficulté pour nous est la manutention : cette partie pèse…
com.dsi.gazette.Article : 42280
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.