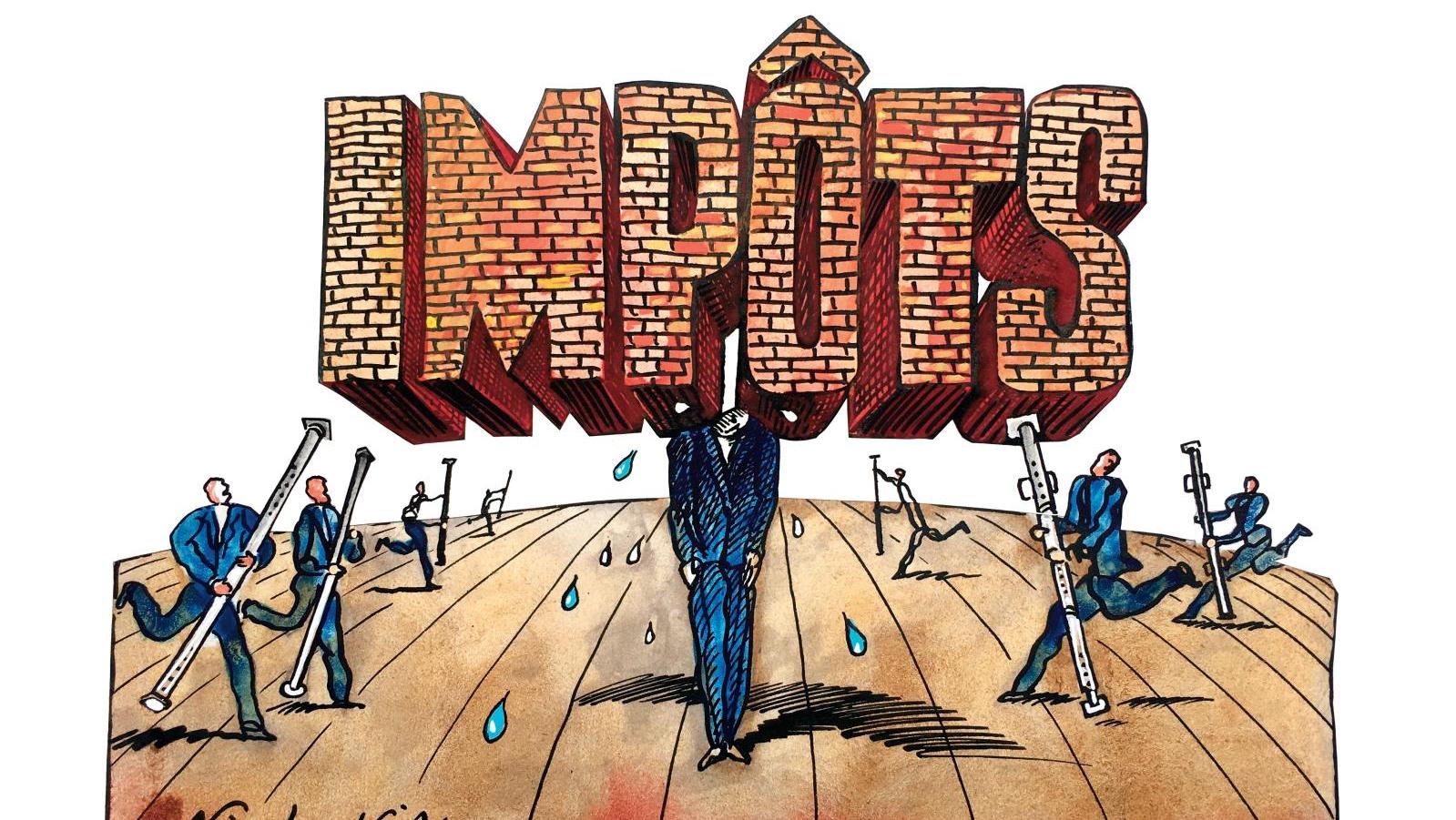Les métiers d’art contribuent au maintien de traditions et à la mise en œuvre d’un savoir-faire de haute technologie. Un crédit fiscal encourage et soutient les entreprises de ce secteur, qu’elles soient artisanales ou industrielles.
Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) permet aux entreprises de ce secteur de soustraire de leur impôt sur le revenu, ou de leur impôt sur les sociétés, un pourcentage des dépenses engagées pour la réalisation de tout ou partie de leurs activités. Initialement mis en place à titre temporaire pour les années 2006 et 2007, le dispositif a été reconduit à plusieurs reprises et vient d’être prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 (article 244 quater O du Code général des impôts). Il a connu plusieurs modifications. Ainsi, son périmètre a d’abord été limité à l’activité de conception de nouveaux ouvrages, puis a été aménagé aux dépenses de création d’ouvrages réalisés en exemplaire unique ou en petite série. Depuis le 1 er janvier 2017, il s’étend aux entreprises qui œuvrent dans le domaine de la restauration du patrimoine. Trois catégories d’entreprises sont visées par le CIMA. Tout d’abord, celles dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent l’un des métiers d’art énumérés par un arrêté du 24 décembre 2015 représentent…
com.dsi.gazette.Article : 7621
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.