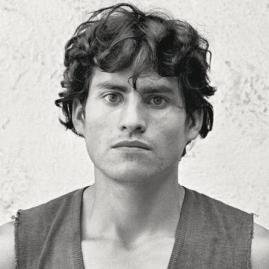Née dans une famille où l’on recevait Alain Bombard, Georges Duhamel, Elisabeth Schwarzkopf et Herbert von Karajan, la collectionneuse d’art contemporain et de photographie Astrid Ullens de Schooten Whettnall a créé la Fondation A Stichting, il y a tout juste dix ans.
Comment êtes-vous devenue collectionneuse ? J’ai commencé par l’art contemporain dans les années 1980, en travaillant avec la galeriste anversoise Micheline Szwajcer, grâce à laquelle j’ai rencontré les plus grands sculpteurs et peintres de l’époque, comme Carl Andre, On Kawara, Stanley Brouwn, Alighiero Boetti… Ayant grandi dans une famille très cultivée, ce fut un bain de jouvence. Car avant de travailler, j’avais une vie de femme au foyer obéissante, mère de quatre enfants. Ces deux univers restaient séparés : je n’osais pas montrer mes acquisitions chez moi. Comment en êtes-vous venue à la photographie ? Quand j’ai pris conscience que l’art contemporain devenait un business, c’est-à-dire quand l’argent a pris le pas sur le travail des artistes… Ce n’est pas ma conception des choses. Je n’ai jamais acheté par spéculation. Je ressentais le besoin de me documenter, de rencontrer les artistes, d’échanger avec eux. Certes, certains étaient chers – j’ai acquis des œuvres à 15 000 €, c’était un gros effort – mais les prix n’étaient pas démesurés comme par la suite. Du jour au lendemain, j’ai tout arrêté. La photo est venue par l’achat d’un tirage de Brancusi à la foire de Bâle, à défaut d’acquérir…
com.dsi.gazette.Article : 37030
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.