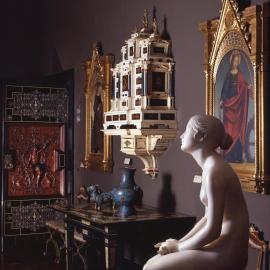1515, année où François d’Orléans accède au trône, prenant la succession de son cousin Louis XII, est aussi celle de la victoire de Marignan. Le prospère royaume de France s’affirmera alors comme un pays moderne, doté d’institutions stables.
De Marignan à Pavie, pendant dix années, François I er (1494-1547) s’emploie à remodeler son royaume, taillant sans merci dans les privilèges aristocratiques et ecclésiastiques hérités du Moyen Âge et posant les bases de la France jusqu’à la Révolution : affirmation du pouvoir royal, priorité à la langue française, essor industriel, mécénat culturel et, non des moindres, portrait du souverain comme instrument…
com.dsi.gazette.Article : 7756
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.