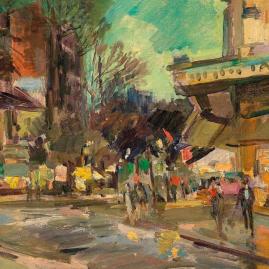Il fait partie des artistes non-conformistes russes révélés en France par Dina Vierny en 1973, aux côtés d’Ilya Kabakov et de Vladimir Yankilevsky. Rencontre avec un homme attaché plus que tout à la liberté.
L ’Autoportrait présenté à l’Espace musées de Roissy, dans le cadre de l’hommage à Dina Vierny, est idéal pour aborder l’art d’Erik Boulatov (né en 1933). Une silhouette graphique au chapeau melon référence à René Magritte à l’intérieur de laquelle s’inscrit, comme des poupées gigognes, le portrait dédoublé de l’artiste. «L’autoportrait évoque ici l’idée que l’auteur vit dans un espace où il se cache, comme à l’intérieur de lui-même, alors qu’à l’extérieur il donne l’impression d’être comme les autres», justifie-t-il. Lors-que Boulatov réalise cette peinture, Paris est porté par le vent de révolte de Mai 68, tandis que l’Union soviétique est encore sous le joug d’un régime totalitaire dirigé par Léonid Brejnev, où il ne fait pas bon s’écarter de la ligne du parti. Alors qu’il étudie à l’Institut d’art Sourikov, à Moscou, «l’histoire de l’art s’arrête à Courbet et à Millet», raconte-t-il. Depuis Staline, l’impressionnisme, le postimpressionnisme et l’art abstrait étaient interdits. «Après la mort de Staline, la création du monde contemporain est enfin arrivée jusqu’à nous. Nous ne connaissions rien !», souffle-t-il. Toutes les toiles de l’avant-garde dormaient…
com.dsi.gazette.Article : 3874
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.