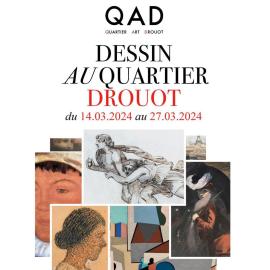Sa 27e édition transforme une nouvelle fois l’ancienne Bourse en palais des découvertes, et effeuille avec délicatesse les multiples pétales d’un médium qui éclot avec le retour du printemps.
Le printemps tant attendu sur la capitale apporte avec lui le retour d’une nouvelle saison artistique, dont le Salon du dessin demeure l’acmé. À chaque édition désormais, de jeunes pousses grandissent sur les murs. Yves Zlotowski, dont la galerie y expose depuis dix ans, l’exprime clairement : «Les amateurs d’art moderne adorent l’ambiance du Salon du dessin, plus intimiste, plus accessible et moins frénétique que celle des grandes foires». Et une belle harmonie règne entre les habitués et les nouveaux. Ces derniers seront au nombre de cinq : les Londoniens Lowell Libson & Jonny Yarker Ltd et Omer Tiroche, la Zurichoise Annemarie Verna, la maison Rosenberg & Co de New York et Onno Van Seggelen Fine Arts de Rotterdam. Tous sont heureux d’être dans les petits papiers des organisateurs. Rosso su rosso Mais on vient aussi au palais Brongniart pour y admirer de belles œuvres de maîtres anciens, car si ces feuilles sont de plus en plus rares sur le marché tant des ventes aux enchères que des foires internationales chacun sait qu’au Salon du dessin il peut s’attendre à être heureusement surpris. Cette édition enfonce le trait en mettant en avant une apparition : une Tête de saint Jean-Baptiste dessinée à la sanguine sur fond de lavis de sanguine la fameuse technique du rosso su rosso de Léonard de Vinci , entre 1510 et 1520, par Cesare da Sesto (1477-1523) l’un des meilleurs élèves du maître florentin. Il s’agit d’une étude pour la Salomé du Kunsthistorisches Museum de Vienne, et plus encore que sur l’œuvre définitive, la tête du saint, dépouillée et extraite du contexte de la composition, frappe par son intensité dramatique. Une vraie fierté que cette découverte pour Matthieu de Bayser, puisque seuls trois dessins préparatoires au même tableau étaient jusque-là connus (Windsor Castle, Academia de Venise, Berlin), dans un corpus pour lequel la monographie de référence, publiée…
com.dsi.gazette.Article : 4688
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.