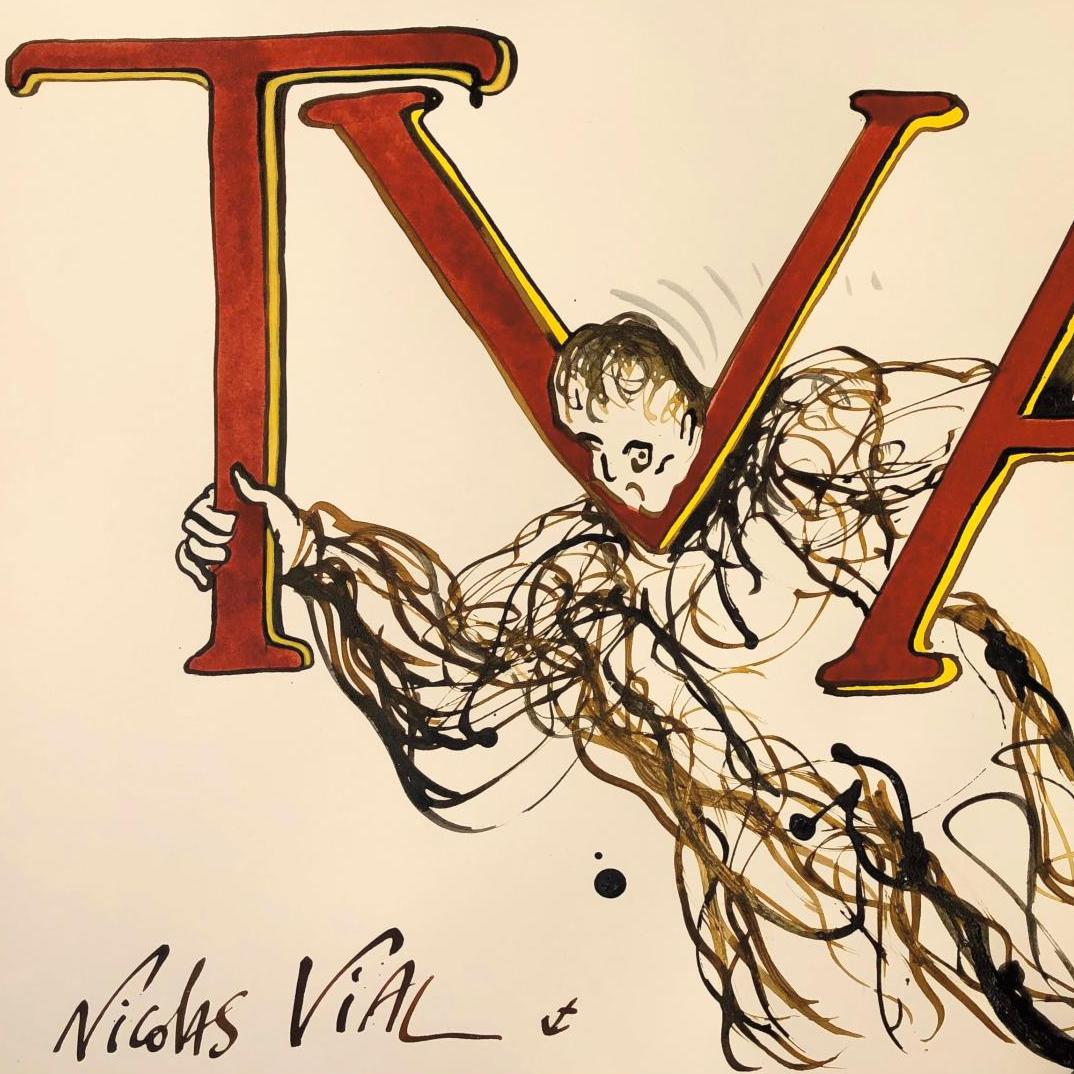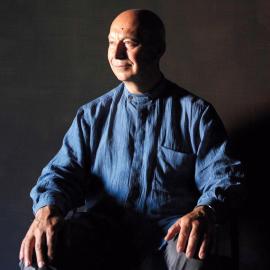Issu du marché des curiosités, le métier d’antiquaire a pris son essor au XIXe siècle, à la disparition de l’Ancien Régime. Avec l’afflux d’objets d’art, le marché de l’occasion n’est alors plus réservé aux indigents.
Durant la Révolution française, la désinvolture à l’égard du mobilier ancien a incité à piller, détruire ou vendre les biens de la famille royale. Réalisés notamment par Georges Jacob, les meubles cassés servent alors à chauffer une troupe de sans-culottes stationnés sous les fenêtres des appartements de Marie-Antoinette… Mais les ventes aux enchères de ces trésors font le bonheur des marchands anglais, allemands et autrichiens. Ce soudain intérêt suscite alors l’attention des premiers curieux pour les vestiges de l’Ancien Régime, car la vente d’objets usés avait jusque-là coutume de s’effectuer dans le tumulte des colporteurs de rue. Les biffins et chiffonniers ont encore l’apanage de ce commerce de regrat et de récupération, au sein d’une communauté qui fait feu de tout bois, et même des boiseries de Versailles, afin d’en extraire d’infimes quantités d’or à partir des dorures d’ornementation. Progressivement, les guerres de l’Empire finissent par ruiner une partie de la classe nobiliaire, qui conserve son train de vie en vendant progressivement son patrimoine. Leurs…
com.dsi.gazette.Article : 6881
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.