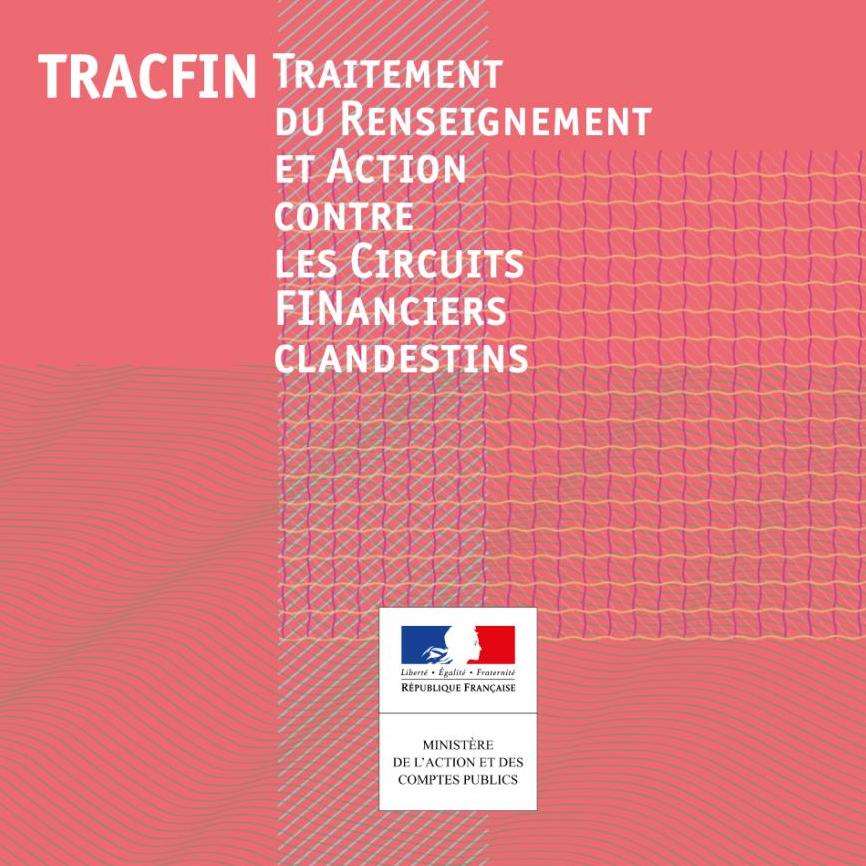En confiant le contrôle des ventes aux enchères aux douanes, le gouvernement entend relancer la lutte contre la criminalité financière sur le marché de l’art.
Désormais, en matière de lutte contre le blanchiment, rejoignant les marchands d’art et d’objets précieux, les commissaires-priseurs sont placés sous la surveillance du service des douanes, et non plus de leur propre Conseil des ventes. En cas de défaillance, ils seront passibles de la Commission nationale des sanctions, instaurée en 2009 pour réprimer les manquements des agences immobilières ou des opérateurs de jeux. C’est l’un des effets d’une ordonnance signée le 12 février, qui vise à mettre en application la cinquième directive européenne de 2018. Le calendrier est serré, car la France est sur le point de faire l’objet d’une évaluation du groupe d’action international mis en place par le G7 – le GAFI –, qui pourrait bien prendre pour cible le marché de l’art. Les sanctions en cas de faute sont également aggravées, pouvant aller jusqu’à cinq ans d’interdiction d’exercer et des amendes de 5 M€, voire le double dans certains cas, et très…
com.dsi.gazette.Article : 13609
Cet article est réservé aux abonnés
Il vous reste 85% à lire.